PMI : 80 ans et un avenir qui se joue maintenant
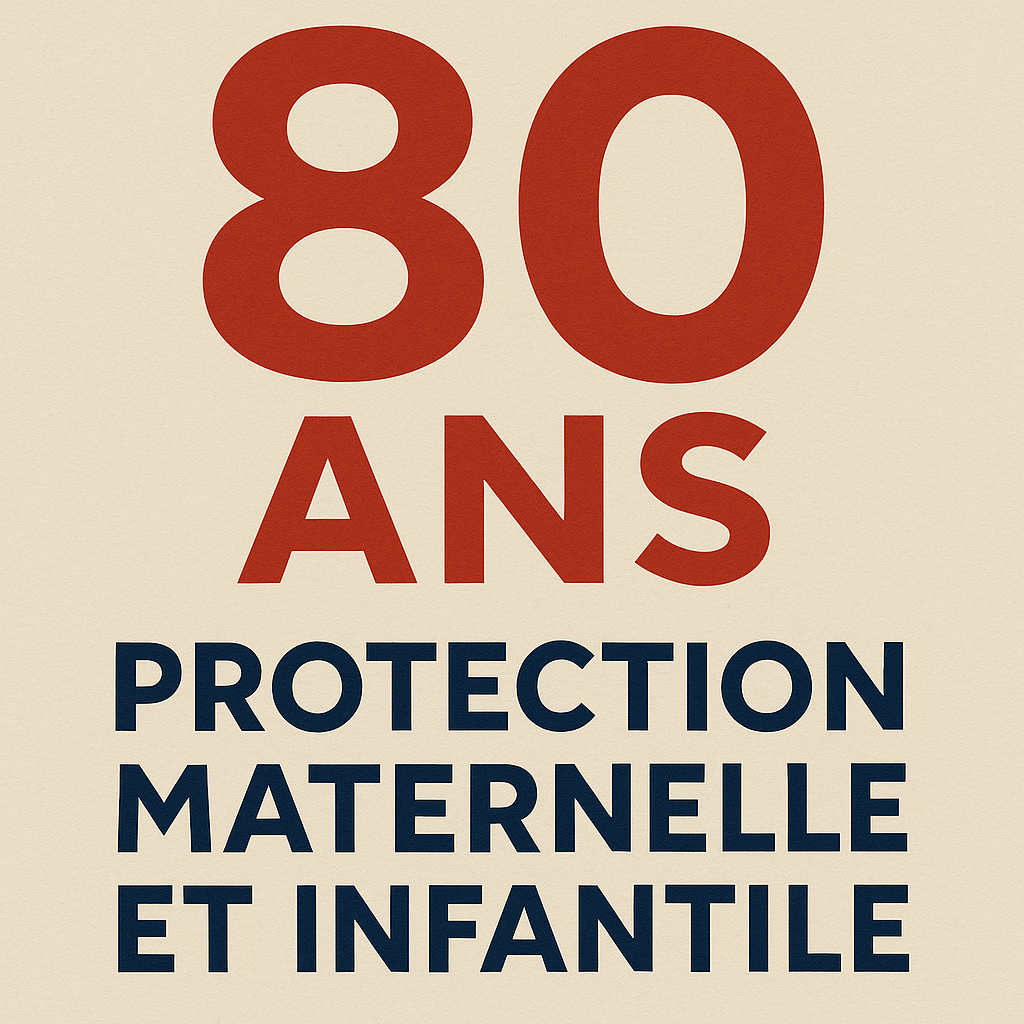
16 novembre 2025
Quatre-vingts ans après sa création, la Protection maternelle et infantile PMI reste l’un des rares services publics capables d’agir là où tout se joue : les premières années de vie. Né en 1945 pour lutter contre une mortalité infantile alors dramatique, ce dispositif territorial gratuit accompagne aujourd’hui femmes enceintes, jeunes enfants et familles dans un contexte social et sanitaire de plus en plus tendu. Derrière la longévité de la PMI, il y a surtout une profession : celle des infirmières, généralistes et puéricultrices, dont l’action demeure le cœur battant de la prévention en France.
En 1945, le pays sort meurtri de la guerre. Les décès infantiles dépassent les 100 ‰, les soins sont inégalement accessibles, la nutrition des nourrissons est incertaine. La réponse publique est ambitieuse : visites à domicile, consultations gratuites, accompagnement de la grossesse, surveillance des modes d’accueil, bilans en école maternelle. Pendant plusieurs décennies, la PMI contribue à réduire les inégalités, à soutenir les mères isolées, à repérer les troubles précoces.
Mais depuis vingt ans, les alertes s’accumulent. Les consultations diminuent, les effectifs s’amenuisent, les postes médicaux restent vacants, les inégalités territoriales s’accentuent. Dans certains départements, les retours à domicile après la naissance ne bénéficient plus d’une visite systématique. Dans d’autres, les bilans de maternelle sont repoussés ou supprimés. Les familles les plus vulnérables se retrouvent face à des guichets saturés, alors qu’elles sont précisément celles pour lesquelles ce service a été créé.
"Si la PMI tient encore debout, c’est grâce à ses équipes, et en premier lieu grâce aux infirmières IDE et IPDE : deux niveaux de compétences au service d’une même mission" souligne Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers SNPI.
Les infirmières généralistes (IDE) assurent l’essentiel des consultations et des visites à domicile. Elles observent les interactions parent-enfant, accompagnent les premiers jours de vie, soutiennent l’allaitement, repèrent la dénutrition et les troubles de développement, orientent les familles vers les acteurs sociaux et médicaux. Elles sont souvent les premières à entrer dans les foyers, les premières à identifier les situations de danger ou de vulnérabilité silencieuse.
Les infirmières puéricultrices (IPDE) ajoutent à cette mission une expertise spécifique de la petite enfance. Leur formation approfondie en pédiatrie, développement et parentalité en fait des professionnelles clés pour les bilans de santé en maternelle, l’évaluation des modes d’accueil, l’accompagnement des nourrissons fragiles, la prévention des accidents domestiques, la dépistage précoce des troubles neurosensoriels ou psycho-affectifs. Leur rôle est reconnu comme structurant depuis le rapport Peyron. Pourtant, leur présence recule dans plusieurs départements, remplacées par des professionnels moins formés aux enjeux du 0-6 ans. Une dérive qui fragilise la sécurité des enfants autant que la qualité du service public.
Une montée des vulnérabilités que la PMI ne peut plus absorber seule
La France connaît aujourd’hui une dégradation silencieuse de la santé des plus jeunes. La mortalité infantile repart à la hausse. Des enfants dorment dehors. D’autres souffrent de carences nutritionnelles que l’on croyait disparues. Les troubles du langage, du comportement ou du sommeil explosent. Les familles isolées cumulent précarité économique, difficultés psychiques, logements insalubres.
La PMI est l’un des rares dispositifs capables d’agir en amont, sans condition de ressources, sans avance de frais, sans barrière administrative. C’est là que se mesurent les tensions contemporaines : ce sont les mêmes infirmières qui doivent répondre à l’urgence sociale, aux inquiétudes parentales, aux retours de maternité, aux besoins de dépistage, aux réorientations vers les services sociaux, aux violences intrafamiliales. Avec des effectifs insuffisants, la prévention s’effiloche, et la perte de chance grandit.
L’atout majeur de la PMI n’est ni sa structure administrative, ni son ancienneté. C’est son modèle relationnel. L’infirmière, qu’elle soit IDE ou IPDE, prend le temps d’observer, d’écouter, de comprendre ce qui se joue dans un foyer. Elle voit les signaux faibles : un nourrisson qui ne suit plus sa courbe, une mère qui s’isole, un tout-petit qui ne répond pas au regard, un environnement surchargé de facteurs de risque. Ce travail clinique, discret et patient, protège des milliers d’enfants chaque année. Il repose sur un cadre éthique : respect, non-jugement, soutien à la parentalité, capacité à intervenir au bon moment. Aucun algorithme, aucun téléservice, aucune plateforme ne peut remplacer cette présence.
Pour que les 80 ans de la PMI soient autre chose qu’une commémoration, quatre décisions politiques s’imposent :
- 1 Reconstruire les équipes infirmières.
Sans recrutement, sans fidélisation, sans attractivité, la PMI continuera de s’effriter. Le service public de la petite enfance et de la parentalité nécessite des effectifs stables, formés et soutenus.
- 2 Protéger la spécialité des puéricultrices.
La substitution par des personnels moins qualifiés fragilise la prévention. Le pays doit réinvestir dans la formation IPDE, sécuriser leurs postes et reconnaître leur expertise. Il faut élargir le champ d’intervention des puéricultrices pour leur permettre un suivi autonome des nourrissons. L’Etat doit faire aboutir la refonte de leur formation, et leur reconnaitre le grade Master.
- 3 Restaurer la priorité nationale donnée à la prévention 0-6 ans.
Les premières années conditionnent toute la santé future. Investir dans la PMI n’est pas un coût : c’est un amortisseur social, un levier d’équité et un outil de santé publique. Il faut systématiser les visites à domicile après la naissance, particulièrement pour les familles précaires ou isolées en créant des unités mobiles de suivi périnatal avec des infirmières et des puéricultrices pour aller au contact des familles qui ne se déplacent pas en centre de santé, en particulier pour le dépistage des infections, de la jaunisse et des troubles alimentaires.
- 4 Mieux articuler PMI, hôpital, médecine de ville et protection de l’enfance.
Les ruptures de parcours créent les drames. Les infirmières de PMI doivent être pleinement reconnues comme pivot entre les acteurs. Il faut encourager une meilleure coordination entre les hôpitaux, les PMI et les professionnels libéraux pour éviter les ruptures de suivi.
Un service public qui protège l’avenir
La PMI fête ses 80 ans, mais ses missions n’ont jamais été aussi actuelles. Elle reste l’un des rares lieux où une professionnelle peut voir un enfant gratuitement, rapidement, durablement. Là où la désertification médicale s’aggrave, où les inégalités explosent, où les débuts de vie se fragilisent, elle incarne une exigence : ne laisser aucun enfant sans repère, aucun parent sans soutien, aucun risque sans réponse.
Ce qui protège un pays, ce sont ses politiques de prévention. Et ce qui protège la prévention, ce sont les infirmières. Les 80 ans de la PMI rappellent une vérité simple : l’avenir d’une génération se joue dans les premières années, et la France ne peut se permettre de l’oublier.
***************************
Voir également :
– Bébés qui meurent, enfants qui dorment dehors : le double abandon français
https://syndicat-infirmier.com/Bebes-qui-meurent-enfants-qui-dorment-dehors-le-double-abandon-francais.html
– Mortalité infantile : et si les infirmières étaient la réponse que la France ignore ?
https://syndicat-infirmier.com/Mortalite-infantile-et-si-les-infirmieres-etaient-la-reponse-que-la-France.html
– Inflation, précarité et carences : en France, des enfants souffrent du scorbut
https://syndicat-infirmier.com/Inflation-precarite-et-carences-en-France-des-enfants-souffrent-du-scorbut.html