Appeler le 15 avant d’aller aux urgences : filtre ou perte de chance ?
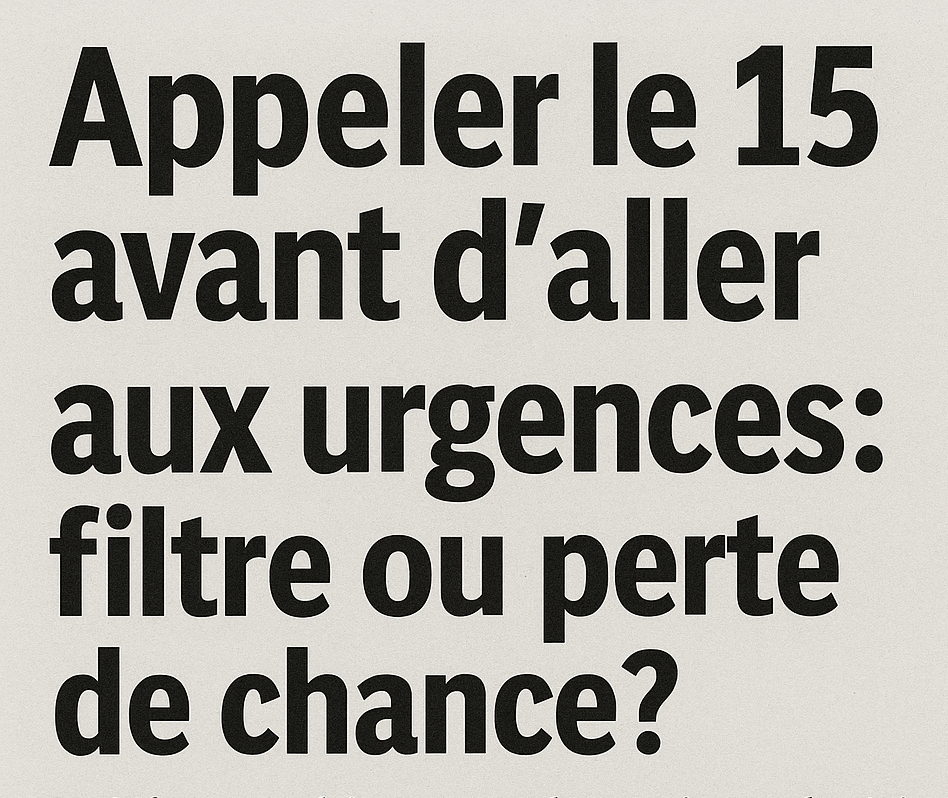
3 septembre 2025
Un infarctus ne laisse que quelques minutes de répit. Mais l’appel au 15 se heurte de plus en plus souvent à des sonneries qui s’éternisent. Et si la solution pensée pour désengorger les urgences créait elle-même de nouvelles pertes de chance ?
Depuis plusieurs années, les autorités sanitaires vantent la régulation téléphonique comme antidote aux services saturés. Le message est simple : avant d’aller aux urgences, il faudrait appeler le 15. Dans certains départements, la règle est désormais contraignante, souvent la nuit et le WE, parfois 24 h sur 24. Dans la Manche, le Calvados ou l’Eure, l’accès est "régulé" 24h/24 par le 15 depuis le début de l’été.
Mais la réalité des chiffres et des faits divers raconte une autre histoire.
En janvier 2025, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a publié une étude sur l’évolution du recours au Samu-Centre 15 à la suite de la crise sanitaire et des mesures de régulation des urgences. La DREES recense plus de 20 millions de dossiers de régulation. C’est 48 % de plus qu’en 2014. Les appels s’accumulent, la file d’attente s’allonge. 80 % seulement sont décrochés en moins d’une minute, contre 85 % les années précédentes. Cela peut paraître marginal. Mais pour un arrêt cardiaque, chaque seconde de silence est un pas vers la mort.
Le site officiel Vie-publique souligne la même tendance : la rapidité de réponse du 15 se dégrade, avec de fortes disparités selon les territoires. Dans certaines régions, décrocher en moins d’une minute relève de l’exception.
Selon le rapport annuel de la DREES, le temps moyen d’attente pour une prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU), suite à un appel au 15, est souvent supérieur aux recommandations. En effet, le temps d’attente moyen dépasse régulièrement les 3 à 4 minutes, alors que les normes internationales recommandent un délai inférieur à 1 minute. Ces délais d’attente excessifs peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des personnes concernées, en retardant leur prise en charge médicale et en compromettant leur pronostic vital dans certains cas urgents.
https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230707610.html
Les dernières données confirment cette tendance. La Cour des comptes pointe un système incapable de fournir des séries fiables, mais les volumes restent record : plus de 20 millions de régulations chaque année.
Côté terrain, le délai moyen d’arrivée des sapeurs-pompiers dépasse désormais 12 minutes, avec de fortes disparités selon les départements, parfois plus de 18 minutes en zone rurale. Chaque minute compte pourtant : les études internationales rappellent qu’en cas d’arrêt cardiaque, la survie diminue de 6 à 10 % par minute sans défibrillation. Pour un AVC ischémique, c’est 1,9 million de neurones détruits à chaque minute sans reperfusion, ce qui dégrade l’autonomie future. Autrement dit, le temps perdu au téléphone ou sur la route se paie en vies amputées.
Dans certains départements, les délais d’attente au 15 en début de soirée peuvent dépasser 20 minutes, en raison d’un afflux massif de appels. Les drames ne manquent pas. Ces affaires ne sont pas des statistiques. Elles sont devenues des symboles.
En Loire-Atlantique, toutes les urgences du département sont filtrées la nuit, pour trois ans. Une décision prise en plein été, mais qui transforme une mesure de crise en norme permanente. L’ARS observe une baisse de 15% des passages nocturnes aux urgences après mise en place de l’appel obligatoire. D’autres départements annoncent des résultats similaires. Mais au niveau national, la tendance reste inverse. Depuis 2024, la fréquentation globale des urgences repart à la hausse, notamment chez les plus de 75 ans. L’idée d’un désengorgement durable par la seule régulation téléphonique n’est pas confirmée.
Un autre angle fragilise le modèle : les résidents d’EHPAD. La nuit, les équipes sont réduites, les médecins absents. En cas de doute, le réflexe est d’appeler le 15. Le régulateur, faute d’alternatives disponibles, oriente souvent vers l’hôpital. Résultat : des transferts jugés inappropriés par la littérature scientifique, coûteux et traumatisants pour les patients. Un tiers des passages aux urgences de résidents en établissement auraient pu être évités, rappellent plusieurs études françaises. Mais encore faut-il proposer autre chose qu’un lit d’hôpital.
Les Samu tentent de répondre par la méthode. En septembre 2025, la Société française de médecine d’urgence, Urgences de France, le Collège de médecine générale et plusieurs associations professionnelles ont publié une échelle de tri nationale. Objectif : aider les assistants de régulation médicale à hiérarchiser les appels et à orienter plus vite. Cet outil vise à réduire l’hétérogénéité des pratiques. Mais il ne remplace pas des effectifs. La mission flash de 2022 l’avait déjà martelé : l’objectif est un décroché en 30 secondes au premier niveau, avec des postes ARM et médecins régulateurs supplémentaires.
La Cour des comptes confirme la pression. +26 % d’appels depuis 2019, près de 16 millions de dossiers de régulation médicale, 730 000 sorties de SMUR en 2022. La machine est en surrégime.
"Le paradoxe est cruel. Pour alléger les urgences de l’hôpital, on surcharge le 15. Pour éviter la file d’attente physique, on crée une file d’attente sonore. Et au milieu, des patients pour qui chaque minute est vitale." alerte Thierry AMOUROUX, Porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI.
Au-delà des chiffres, une question persiste. La régulation peut sauver du temps médical quand elle est rapide, dotée, et connectée à des alternatives réelles : médecins de ville, équipes mobiles, hospitalisation à domicile. Mais que vaut un filtre qui ne mène qu’à une impasse ?
Les soignants de terrain le disent : sans lits disponibles, sans astreintes gériatriques, sans solutions de proximité, la régulation devient un passage obligé qui reporte le problème au lieu de le résoudre.
La logique initiale était séduisante : un tri en amont, pour réserver les urgences aux vraies urgences. L’expérience montre une autre facette : des délais rallongés pour les détresses vitales, des orientations par défaut pour les plus vulnérables, et une confiance fragilisée par les drames médiatisés.
La question reste entière : en imposant le 15 comme porte d’entrée, l’hôpital s’allège-t-il vraiment, ou reporte-t-il son encombrement sur une ligne déjà saturée ?
*****************
– La régulation par le 15 entraîne des pertes de chances aux urgences
https://www.infirmiers.com/profession-ide/actualite-sociale/la-regulation-par-le-15-entraine-des-pertes-de-chances-aux-urgences
– https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/235972/appeler-le-15-avant-daller-aux-urgences-filtre-ou-perte-de-chance-communique/
– Urgences : un tiers des hôpitaux en situation dégradée cet été
https://www.infirmiers.com/profession-ide/actualite-sociale/urgences-un-tiers-des-hopitaux-en-situation-degradee-cet-ete
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************