Canicule et pénurie : quand les urgences ferment, les risques explosent à l’hôpital
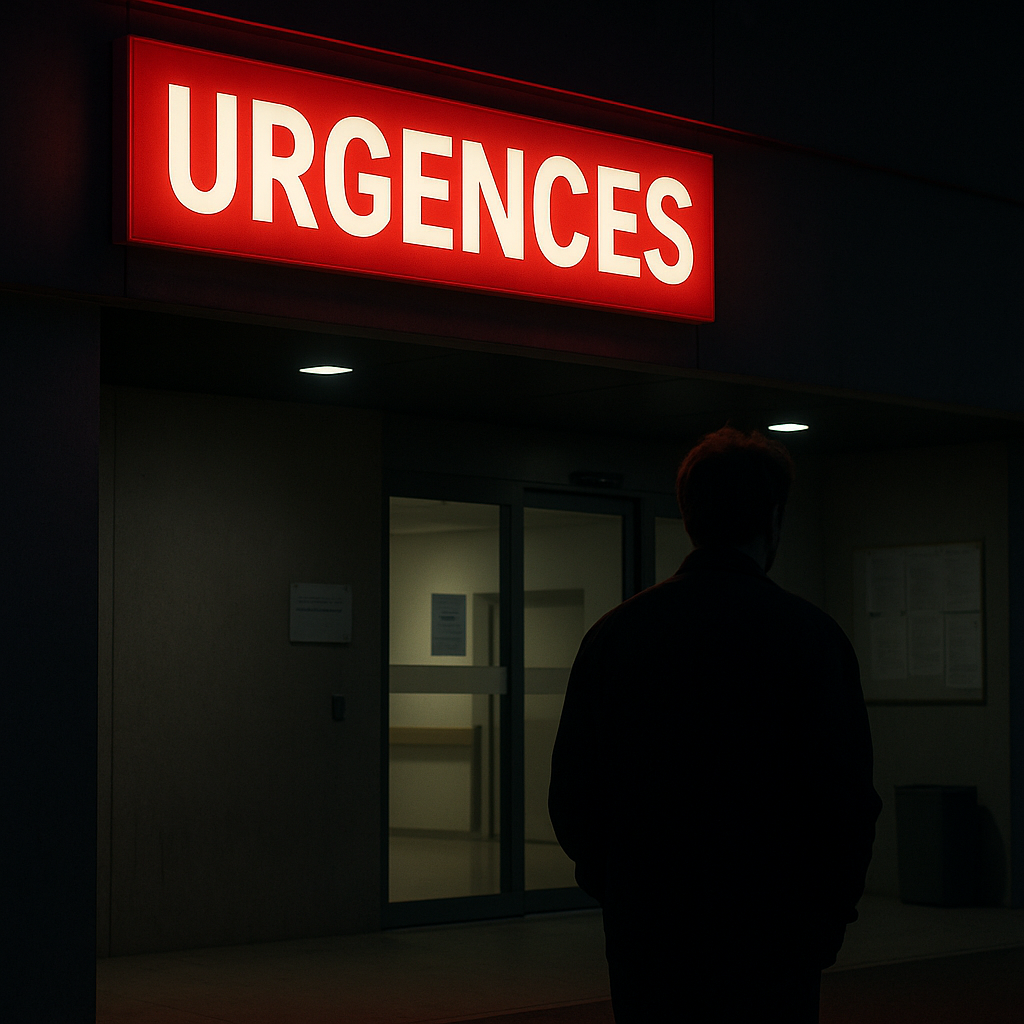
13 août 2025
Les urgences doivent rester ouvertes 24 heures sur 24. C’est la base d’un service public de santé digne de ce nom. Oui mais… cet été, des dizaines d’établissements ferment leurs portes la nuit ou le week-end. Ce n’est pas une mesure exceptionnelle. C’est devenu une gestion ordinaire de la pénurie.
Pourtant, il suffirait d’anticiper, de doter les services des moyens nécessaires, de donner aux soignants les conditions pour tenir. Chaque été, les solutions sont annoncées, les rapports publiés, les intentions affichées. Et chaque été, elles se heurtent au mur du sous-financement et de l’inaction.
En Bretagne, malgré l’arrivée des vacanciers, 15 des 29 établissements d’urgence fonctionnent désormais sous régulation nocturne : accès uniquement sur appel préalable au 15, de 18h30 à 8h, du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ octobre. Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vannes ou Lannion appliquent tous la même règle : pas d’appel, pas d’entrée.
En Loire-Atlantique, l’ARS a franchi une étape supplémentaire. Depuis le 13 juillet, toutes les urgences du département sont filtrées la nuit, pour trois ans. Une décision prise en plein été, mais qui transforme une mesure de crise en norme permanente.
En Nouvelle-Aquitaine, une quinzaine de services sur 62 limitent l’accès ou ferment certaines plages horaires. À Bordeaux-Bagatelle, portes closes tous les soirs de 20h à 8h. À Saint-Jean-de-Luz, la Polyclinique Côte basque sud a suspendu ses urgences pendant cinq jours début juillet.
Même scénario ailleurs : à Lyon, l’Hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc n’accueille plus aux urgences les week-ends et jours fériés depuis le 28 mai, avec une fermeture continue de 17 jours en août. Dans la Manche, le Calvados ou l’Eure, l’accès est régulé 24h/24 par le 15 depuis le début de l’été.
Et maintenant ? Une semaine de canicule frappe le pays. Les autorités affirment que les hôpitaux sont « prêts à répondre ». Sur le terrain, les fermetures nocturnes et les régulations téléphoniques restent en place. En juillet, le CHU de Nîmes avait activé un plan Hôpital en tension (HET) niveau 2 pour absorber l’afflux de patients lié à la chaleur. Un geste isolé, loin d’une réponse coordonnée à l’échelle nationale.
Car le niveau élevé des températures entraîne une hausse marquée des passages aux urgences, en particulier chez les personnes âgées, les patients chroniques, et les publics vulnérables. Cette situation engendre des tensions importantes sur les capacités d’accueil et d’hospitalisation en aval, en particulier dans les services de médecine.
Dans la plupart des régions, la carte des restrictions ne bouge pas. Ceux qui tombent malades ou se blessent la nuit devront composer avec un filtre téléphonique, attendre un feu vert pour être dirigés vers un service ouvert, ou parcourir des dizaines de kilomètres.
Mention spéciale pour le Calvados, département dans lequel depuis 1er juillet, l’accès à l’ensemble des services d’urgences du Calvados sera "régulé" (novlangue orwellienne pour ne pas dire "en accès dégradé") 24h/24 ! L’appel au 15 est obligatoire avant tout déplacement aux urgences. Cette organisation intervient dans le contexte de la forte fréquentation touristique du département en été !
Chaque été, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pénurie de personnel, postes vacants, intérim épuisé, recours aux heures supplémentaires jusqu’à la rupture. Les directions invoquent la sécurité : mieux vaut fermer que d’accueillir avec des équipes épuisées ou incomplètes.
Les pouvoirs publics promettent des « plans de renfort », des « missions flash », des « task forces estivales ». Les rapports d’experts se succèdent. Les constats sont connus depuis des années. Mais sans budget supplémentaire, ces annonces restent des mots.
Pire : la situation se dégrade, année après année. L’ONDAM, l’enveloppe nationale pour les dépenses de santé, reste inférieur de moitié aux besoins estimés. Le sous-financement est structurel. Les fermetures temporaires deviennent la norme. Ces situations dégradées et la perte de sens font fuir les soignants, qui ont au quotidien deux fois plus de patients que les normes internationales !
La fermeture partielle des urgences n’est pas neutre. Elle pèse directement sur la sécurité des patients. Dans son rapport publié le 6 février 2023, SAMU-Urgences de France recensait 43 décès inattendus de patients, en seulement deux mois (1ᵉʳ décembre 2022 – 31 janvier 2023). Ces chiffres ne concernent que les signalements volontaires de praticiens de 22 départements. Parmi ces décès, 79 % des victimes attendaient alors une prise en charge dans un service d’urgences, 21 % étaient en situation pré-hospitalière. Ce n’est donc pas seulement l’hôpital qui est en cause : c’est toute la chaîne d’accès aux soins d’urgence qui est fragilisée.
La Drees, dans une étude nationale sur les urgences, confirme la dégradation. En dix ans, le temps d’attente moyen a sérieusement augmenté. La cause : l’augmentation des passages, la complexité des cas, et surtout la réduction des effectifs disponibles.
https://www.vie-publique.fr/en-bref/297806-urgences-hospitalieres-un-temps-dattente-augmente-pour-les-patients
En zone rurale ou littorale, une fermeture nocturne peut signifier un trajet de 40 à 60 km pour rejoindre le service ouvert le plus proche. En période de canicule, une telle distance peut être fatale à une personne âgée en détresse respiratoire, à un nourrisson déshydraté, ou à une victime d’accident.
Pour les équipes, ces fermetures partielles sont un aveu d’impuissance. Elles savent que derrière chaque appel refusé, chaque patient réorienté, il y a un risque. Les médecins régulateurs au 15 doivent décider, en quelques minutes, si un patient peut attendre ou doit être envoyé immédiatement. Les ambulances s’allongent sur les routes, les hôpitaux restants se saturent, les soignants basculent en mode crise permanente.
Les fermetures la nuit et le week-end ne réduisent pas la charge globale. Elles la déplacent. Les patients affluent massivement le matin ou le lundi, aggravant encore la tension sur les équipes et augmentant le risque d’erreurs.
Ce n’est pas un problème de météo. Ce n’est pas une fatalité liée à « la démographie médicale ». C’est une conséquence directe de choix budgétaires et organisationnels. En maintenant l’ONDAM en dessous des besoins, en n’ouvrant pas de postes pérennes, en laissant les salaires stagner, les gouvernements successifs ont organisé la pénurie. Et chaque été, ce manque d’anticipation se paie en vies humaines.
Et après ? Sans un changement radical, l’été 2026 sera le même. Même carte, mêmes fermetures, mêmes discours.
La solution est connue : planification des effectifs sur l’année, recrutement massif par la mise en place de ratios de patients par infirmière, revalorisation salariale pour fidéliser, budgets alignés sur les besoins réels, déclenchement coordonné des plans blancs dès les premiers signaux d’alerte.
Ce qui manque, ce n’est pas le diagnostic. C’est la décision d’investir réellement dans l’accès aux soins d’urgence. Tant que cette décision n’est pas prise, chaque fermeture nocturne ou dominicale reste une loterie où les patients jouent leur vie.
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************
– Urgences : un tiers des hôpitaux en situation dégradée cet été
https://www.infirmiers.com/profession-ide/actualite-sociale/urgences-un-tiers-des-hopitaux-en-situation-degradee-cet-ete