Ratios patients par soignant : une avancée vitale face à ceux qui préfèrent l’immobilisme
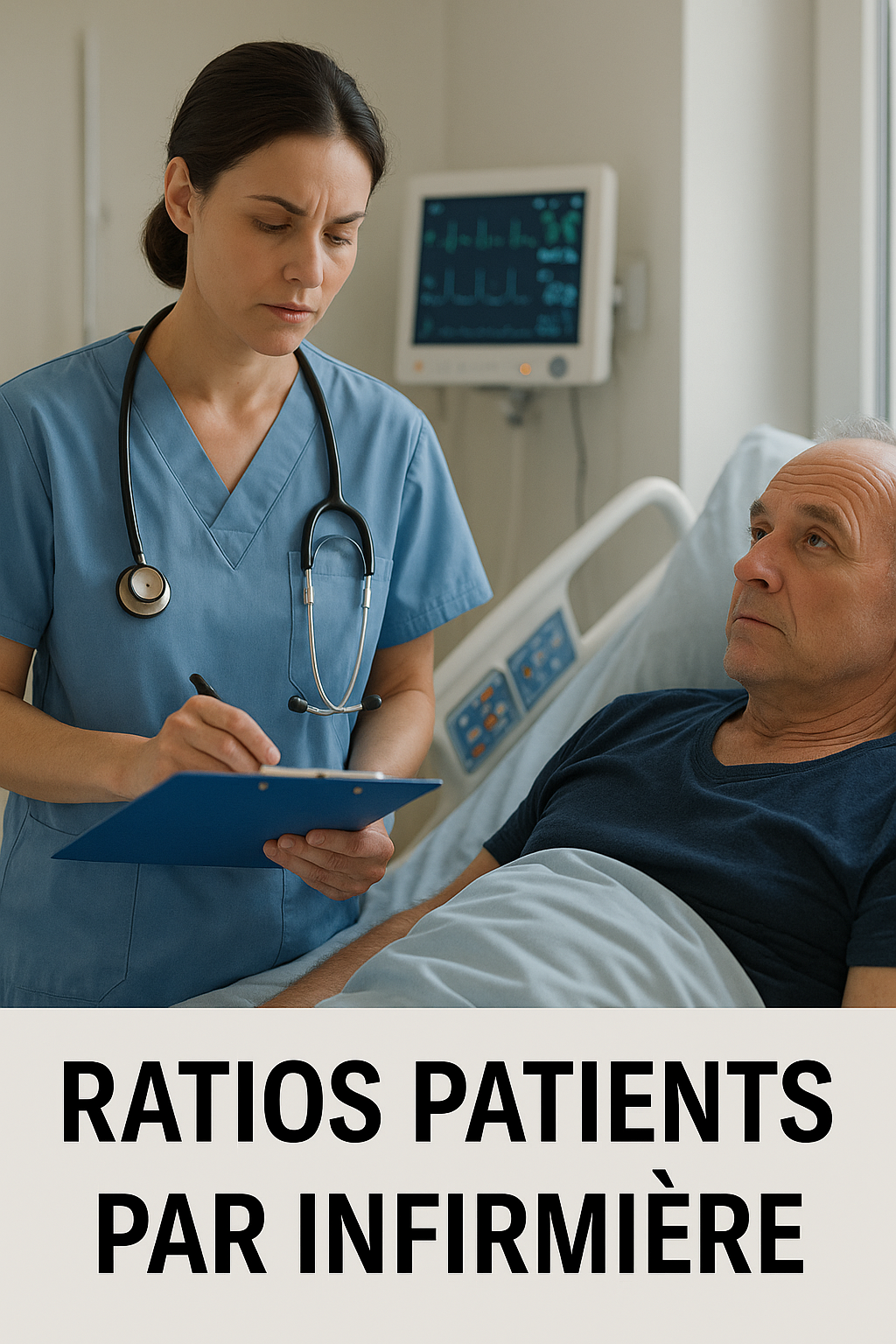
27 juillet 2025
Les opposants aux ratios de patients par soignant développent des arguments techniques pour masquer leur posture de résistance face à une avancée attendue depuis des années par les soignants de terrain. : l’instauration de ratios de patients à l’hôpital. Ne nous y trompons pas. Ce que certains bureaucrates présentent comme une réflexion distanciée sur les « limites du ratio », est en réalité une tentative de discrédit méthodique d’un outil qui sauve des vies. Reprenons point par point les objections soulevées, et montrons pourquoi elles ne tiennent pas face à la réalité clinique, sociale et scientifique.
1) Ratios : une approche arithmétique, déconnectée des besoins réels ?
C’est l’argument central. Dimensionner les effectifs à partir d’un nombre de lits ouverts reviendrait à ignorer les spécificités des patients, des prises en charge, des temporalités du soin. Ce serait même une inversion du raisonnement : « les soins sont choisis en fonction du temps disponible, et non strictement en fonction des besoins des patients ».
Mais c’est précisément ce qui se passe aujourd’hui. Les soignants ne choisissent pas : ils renoncent. Quand une infirmière de médecine polyvalente suit seule 15 à 20 patients, elle n’évalue plus, elle hiérarchise dans l’urgence. Les soins relationnels passent à la trappe. La prévention aussi. L’accompagnement se résume à quelques mots dans un couloir. Non pas parce que les besoins sont faibles, mais parce que les effectifs le sont. Ce n’est pas la norme qui engendre le rationnement, c’est son absence.
Les ratios ne figent pas l’organisation. Ils fixent un socle. Une ligne rouge. En deçà, le soin devient dangereux. La littérature scientifique est claire : en deçà de certains seuils, la mortalité hospitalière augmente, tout comme les événements indésirables évitables, les erreurs de soins, et les infections nosocomiales.
2) Le dimensionnement est une compétence locale, stratégique, complexe
C’est vrai. Dimensionner un service, ce n’est pas appliquer une recette toute faite. Il faut tenir compte des flux, des profils de patients, de l’architecture du service, du turn-over des équipes, des compétences disponibles. Mais justement : ces complexités justifient un travail complémentaire, pas l’absence de minimum légal. C’est pour cela que le législateur a demandé une expertise de la HAS Haute Autorité de Santé. À force d’attendre que chaque établissement définisse librement son propre modèle, on a abouti à une constante nationale : les soignants français prennent en charge deux fois plus de patients que leurs collègues allemands ou néerlandais.
Quand l’autonomie locale devient synonyme de pénurie structurelle, il est légitime que la loi intervienne. Les ratios ne remplaceront jamais une démarche managériale de qualité. Mais ils offrent un garde-fou. Ils disent : en deçà de ce seuil, ce n’est plus du soin, c’est du bricolage.
3) Les ratios sont une logique budgétaire, pas une logique soignante
C’est sans doute l’argument le plus ironique. Car si les hôpitaux sont aujourd’hui contraints à réduire les effectifs, ce n’est pas à cause d’un excès de ratios, mais d’une logique budgétaire non encadrée. Depuis vingt ans, la tarification à l’activité T2A pousse à produire toujours plus avec toujours moins. Le glissement de tâches a été institutionnalisé. Le présentéisme est devenu un indicateur de performance. Les effectifs sont dimensionnés non sur les besoins, mais sur les enveloppes. Et c’est justement ce que les ratios viennent corriger.
"Là où la logique comptable impose de « faire avec ce qu’on a », les ratios rappellent une évidence : sans professionnels en nombre suffisant, pas de soins de qualité, pas de sécurité, pas de dignité. Et les données internationales sont limpides : plus le nombre de patients par infirmière augmente, plus la mortalité hospitalière croît, notamment dans les 30 jours suivant une intervention. À l’inverse, les pays qui ont instauré des ratios minimaux (comme l’Australie, l’État de Californie ou la Corée du Sud) ont constaté une baisse des erreurs de soins, une réduction des complications, et une amélioration du moral et de la santé des soignants." précise Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI.
4) La rigidité organisationnelle contre la souplesse des réalités cliniques
On entend souvent que les ratios risquent de figer les organisations, de les rendre moins réactives aux variations d’activité. Mais ce raisonnement inverse les responsabilités. Ce n’est pas la loi qui impose la rigidité. Ce sont les contraintes budgétaires qui, aujourd’hui, empêchent toute souplesse. L’absence d’effectifs en nombre suffisant ne permet ni d’adapter les horaires, ni de répondre aux imprévus. Quand un agent est absent, on ferme un lit, ou on sursollicite les présents. Ce n’est pas de la flexibilité, c’est de l’improvisation permanente.
En l’absence de garde-fous, le dimensionnement est souvent dicté par des contraintes économiques et des tableaux EPRD, non par la réalité clinique. Les ratios n’empêchent pas d’ajuster, de planifier, de s’adapter. Ils empêchent simplement qu’on laisse une infirmière gérer 14 patients de médecine lourde de nuit, ou un aide-soignant seul en EHPAD pour 45 résidents. Ils ne rigidifient pas le soin, ils le rendent possible.
5) Le ratio ne concerne qu’une partie des soignants : une réforme incomplète ?
Là encore, l’argument est recevable, mais il ne milite pas pour l’abandon de la mesure : il plaide pour son extension. Oui, la loi de janvier 2025 ne concerne que les infirmiers et aides-soignants hospitaliers. Oui, elle laisse de côté les structures médico-sociales, la psychiatrie, les soins à domicile. Mais fallait-il pour autant ne rien faire ? Fallait-il attendre une réforme totale, en risquant de tout reporter ?
Les ratios sont un levier. Une amorce. Ils posent un jalon essentiel dans un mouvement plus large de refondation du soin. Rien n’interdit de les élargir à d’autres secteurs. Au contraire, leur mise en œuvre dans les services les plus à risque permettra de documenter, d’ajuster, et de convaincre. Dans tous les pays, l’avancée s’est faite par étape.
6) La contrainte légale contre l’intelligence organisationnelle ?
Faut-il opposer norme et discernement ? Pas si la norme est minimale. Le ratio n’est pas un modèle unique à appliquer partout. C’est un seuil d’alerte. Un garde-fou contre l’invisibilisation de la souffrance au travail. Un signal d’alerte avant que les erreurs ne deviennent des drames.
Et surtout, les ratios ne s’opposent pas à la responsabilisation des cadres infirmiers, bien au contraire. Ils leur donnent un appui. Un levier pour refuser des organisations intenables. Un outil pour négocier, pour défendre leur équipe, pour dire « non » en s’appuyant sur la loi.
La vraie perte d’autonomie, ce n’est pas la norme. C’est de devoir fonctionner en sous-effectif sans pouvoir le dénoncer. C’est d’être seul face à des injonctions paradoxales : assurer la qualité sans moyens, préserver la sécurité en courant partout, faire de la relation sans avoir le temps de s’asseoir.
Une avancée fragile, qu’il faut défendre
La loi de janvier 2025 a posé un jalon historique. Pour la première fois, l’État reconnaît que les effectifs soignants ne sont pas une variable d’ajustement. Pour la première fois, la France rejoint les standards de pays qui, depuis dix ou vingt ans, ont compris que la qualité a un coût, mais que l’absence de qualité en a un bien plus grand.
Évidemment, tout reste à faire : définir les seuils par spécialité, intégrer les temps de soins indirects, prendre en compte les spécificités des prises en charge complexes. Mais la direction est claire : il faut arrêter de soigner à flux tendu. Il faut sortir de la logique du « toujours moins ».
La complexité sert à justifier l’inaction. Les réticences des directions, malgré leurs apparences techniques, s’inscrivent dans une vision managériale qui a trop souvent fait passer l’efficience avant la pertinence. Face aux soignants qui tombent, aux patients qui attendent, aux erreurs que l’on aurait pu éviter, il faut rappeler une évidence : sans ratio, il n’y a pas de soin sûr.
Les ratios ne rigidifient pas les soins : ils empêchent qu’on les sacrifie. Et si nous voulons encore croire à un avenir pour l’hôpital public, c’est le moment de le prouver. Par la loi. Par les moyens. Par le respect.
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************