Remplacer une infirmière par une aide-soignante, c’est augmenter le risque de décès
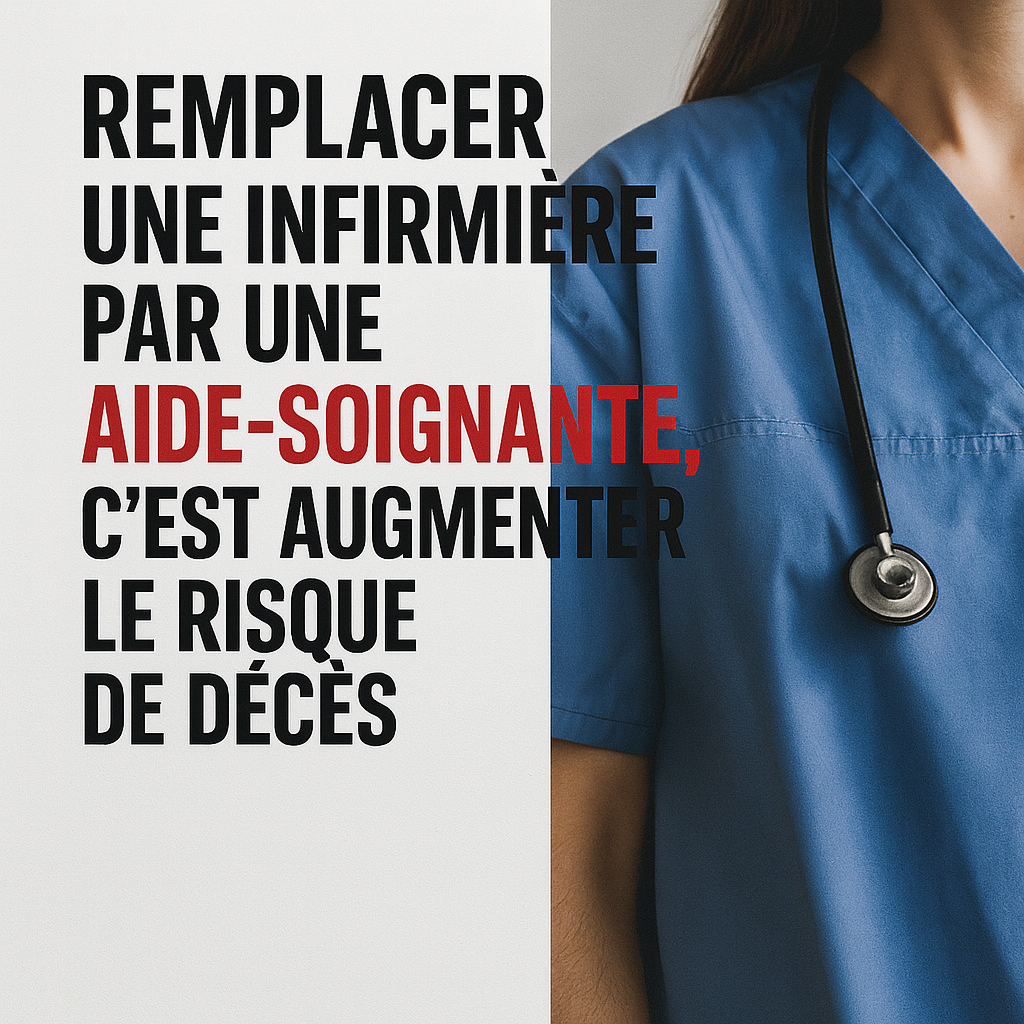
27 octobre 2025
Chaque fois qu’un établissement de santé remplace une infirmière par une aide-soignante pour « faire des économies », c’est une ligne budgétaire qui s’équilibre, mais une vie humaine qui se fragilise. Ce que l’on présente comme une simple réorganisation des équipes est, en réalité, une mise en danger. Deux grandes études internationales, publiées en 2016 et 2024, en apportent la preuve : la déqualification du soin se paie en morts évitables, en complications et en perte de confiance.
Une enquête européenne sans appel
L’étude dirigée par Linda Aiken sur RN4CAST, publiée en 2016 dans BMJ Quality & Safety, a marqué un tournant dans la recherche sur les effectifs infirmiers. Les chercheurs ont analysé les données de sortie de 275.519 patients post-chirurgie, répartis dans 243 hôpitaux en Belgique, Grande-Bretagne, Finlande, Irlande, Espagne et Suisse.
https://qualitysafety.bmj.com/content/26/7/559.short?g=w_qs_ahead_tab
Le résultat est sans ambiguïté : chaque réduction de 10 % de la proportion d’infirmières diplômées dans une équipe augmente de 11 % le risque de décès hospitalier. Et le simple fait de remplacer une infirmière par une aide-soignante pour 25 patients accroît de 21 % la probabilité de mourir à l’hôpital.
Les chercheurs n’emploient pas de langue de bois : « Certaines initiatives politiques devraient être prises avec prudence, en raison des conséquences parfois mortelles pour les patients ». Autrement dit, vouloir faire des économies sur la qualification du personnel soignant revient à déplacer la charge sur les patients eux-mêmes, qui en subissent les effets cliniques et humains.
L’étude montre aussi que les hôpitaux dotés d’un effectif plus qualifié enregistrent moins de chutes, moins d’escarres, moins d’infections urinaires, et une meilleure satisfaction des patients. Là où la compétence infirmière diminue, les erreurs augmentent, la vigilance s’affaiblit, et la sécurité s’effrite.
Le soin déqualifié : un modèle dangereux
Huit ans plus tard, une nouvelle recherche publiée en 2024 dans la revue Medical Care, conduite par Karen Lasater et son équipe de l’Université de Pennsylvanie, confirme et amplifie ces constats. Portant sur 6,5 millions de patients dans 2 676 hôpitaux américains, cette étude évalue les effets d’une réduction de la proportion d’infirmières diplômées dans les équipes.
https://journals.lww.com/lww-medicalcare/fulltext/2024/07000/alternative_models_of_nurse_staffing_may_be.2.aspx
Les résultats sont édifiants : augmentation de la mortalité hospitalière et des réadmissions dans les 30 jours, hausse de la durée des séjours, chute significative de la satisfaction des patients. Les chercheurs estiment qu’une baisse de 10 points de pourcentage d’infirmières diplômées entraînerait près de 11.000 décès évitables et 5.200 réhospitalisations supplémentaires chaque année, pour un coût global d’environ 3 milliards de dollars en pertes économiques.
Leur conclusion est claire : « Réduire la proportion d’infirmières, même en maintenant le nombre total d’heures de soins, se traduit par des décès, des réadmissions et des séjours plus longs. »
Autrement dit, la substitution d’infirmières par des aides-soignants ou des personnels moins qualifiés ne constitue pas une innovation organisationnelle : c’est un retour en arrière dangereux.
Le mirage de l’économie immédiate
Dans les faits, cette politique de baisse des qualifications (moins d’infirmières, plus d’aides-soignants) repose sur un calcul à courte vue. Le raisonnement économique semble implacable : les aides-soignants coûtent moins cher, donc on en recrute davantage. Mais les études montrent que cette économie apparente se transforme rapidement en surcoût sanitaire et financier.
Allonger les durées de séjour, multiplier les complications, réadmettre les patients quelques jours plus tard, mobiliser davantage de lits : tout cela a un coût. Un coût invisible dans les tableaux Excel, mais bien réel dans les budgets hospitaliers et les vies humaines. les politiques de déqualification sont des économies toxiques. À court terme, elles allègent une ligne comptable ; à long terme, elles pèsent sur les comptes publics et sur la conscience de ceux qui décident.
La dimension éthique du soin
Derrière ces chiffres se cache une question fondamentale : qu’est-ce qu’un soin sûr ? Un acte technique isolé ne suffit pas à sécuriser un patient ; c’est la présence clinique, le raisonnement professionnel, l’observation continue qui font la différence. Ces compétences relèvent du métier infirmier.
L’aide-soignant a un rôle essentiel, complémentaire, mais il n’a ni la formation, ni la responsabilité clinique, ni la capacité d’analyse globale du patient. Substituer un profil à l’autre, c’est confondre la coopération avec la dilution des responsabilités.
Cette confusion traduit une perte de sens. Car l’infirmière n’est pas seulement « un poste » ou « un coût ». Elle est la garante de la continuité du soin, la première à repérer un signe de dégradation, la dernière à quitter la chambre quand le patient ne va pas bien. C’est cette vigilance silencieuse qui sauve des vies.
Pour Thierry Amouroux, porte-parole du SNPI CFE-CGC, ces études confirment un constat que les soignants expriment depuis des années : « Les transferts de tâches, la déqualification des soins et les plans d’économies dans les hôpitaux débouchent clairement sur des morts, tués par des bureaucrates cyniques ou incapables de faire le lien entre leurs décisions et les décès qui en découlent. »
Cette déclaration peut choquer, mais elle traduit une réalité : les décisions prises loin du terrain ont des effets concrets sur la vie des patients. Entre un ratio “optimisé” sur papier et une réanimation à deux soignants au lieu de trois, la différence se compte en battements de cœur.
Le cas français : un avertissement ignoré
En France, les effectifs infirmiers se sont effondrés dans les hôpitaux publics : 43.500 lits supprimés en dix ans, des postes vacants non remplacés, des contractuels épuisés. Dans ce contexte, la tentation est grande d’élargir les délégations, d’introduire des « nouvelles catégories » intermédiaires, ou de mutualiser les soins entre services. En EHPAD, les établissements privés font souvent appel à des personnes non qualifiées "faisant fonction d’aides-soignants" (il n’y a que 10% d’infirmières et 35% d’aides-soignants, d’où une "perte de chance", alors que l’Allemagne à 2 fois de soignants par résident).
La loi du 29 janvier 2025 sur les ratios soignants/patients ne suffira pas si elle n’intègre pas la dimension qualitative des effectifs. Ce qui sauve les patients, ce ne sont pas les nombres seuls, mais la proportion d’infirmières diplômées dans les équipes. Sans cela, un ratio peut masquer une déqualification organisée.
L’État, qui se veut garant de la sécurité sanitaire, doit entendre ce message : la qualité des soins n’est pas compatible avec la logique d’austérité permanente.
Repenser le soin comme investissement
Les chiffres sont connus : chaque augmentation de 10 % du personnel infirmier qualifié diminue les complications, réduit la durée de séjour et améliore la satisfaction des patients. Autrement dit, l’investissement dans les infirmières génère un retour en santé publique et en efficience économique.
Ce que confirment les études internationales rejoint ce que disent les équipes au quotidien : la présence infirmière est un facteur de stabilité, de prévention et de confiance. La soignante formée ne coûte pas, elle évite le coût du pire : celui de la négligence, de la complication, du décès évitable.
Restaurer la responsabilité et le sens
Remplacer une infirmière par une aide-soignante, c’est faire croire qu’un soin est un assemblage de gestes. C’est oublier qu’il s’agit d’un acte de discernement, de jugement clinique, d’éthique. C’est réduire le soin à une tâche, alors qu’il est une relation.
Les établissements de santé publics et privés ne manquent pas seulement de bras, mais de reconnaissance. Redonner de la valeur à la compétence infirmière, c’est aussi redonner du sens au système de santé.
La France ne pourra pas restaurer la confiance dans son hôpital sans restaurer la place de celles et ceux qui le font vivre, jour et nuit. L’infirmière est le cœur battant du système de soins : la remplacer, c’est désorganiser sa circulation vitale.
Pour une politique du soin fondée sur les preuves
Les données sont là. Les patients, eux, n’ont plus le temps d’attendre. Il est urgent que les gouvernements et directions hospitalières cessent de raisonner en équivalences de postes et intègrent les données probantes issues de la recherche.
Les politiques de santé doivent garantir :
– un seuil minimal de qualification dans les équipes, non négociable ;
– la publication transparente des ratios infirmières/patients ;
– la valorisation du rôle clinique infirmier dans les décisions de soins ;
– et la reconnaissance économique et sociale de cette expertise.
Parce qu’au bout du compte, ce que disent les chiffres, c’est que la présence d’une infirmière diplômée au chevet d’un patient n’est pas un luxe : c’est une garantie de survie.
Le soin n’est pas une variable d’ajustement. L’infirmière est une condition de vie. Et chaque fois qu’on la remplace pour “faire des économies”, on ne réduit pas les dépenses : on réduit les chances de vivre.