Eau potable : un service public en voie de contamination
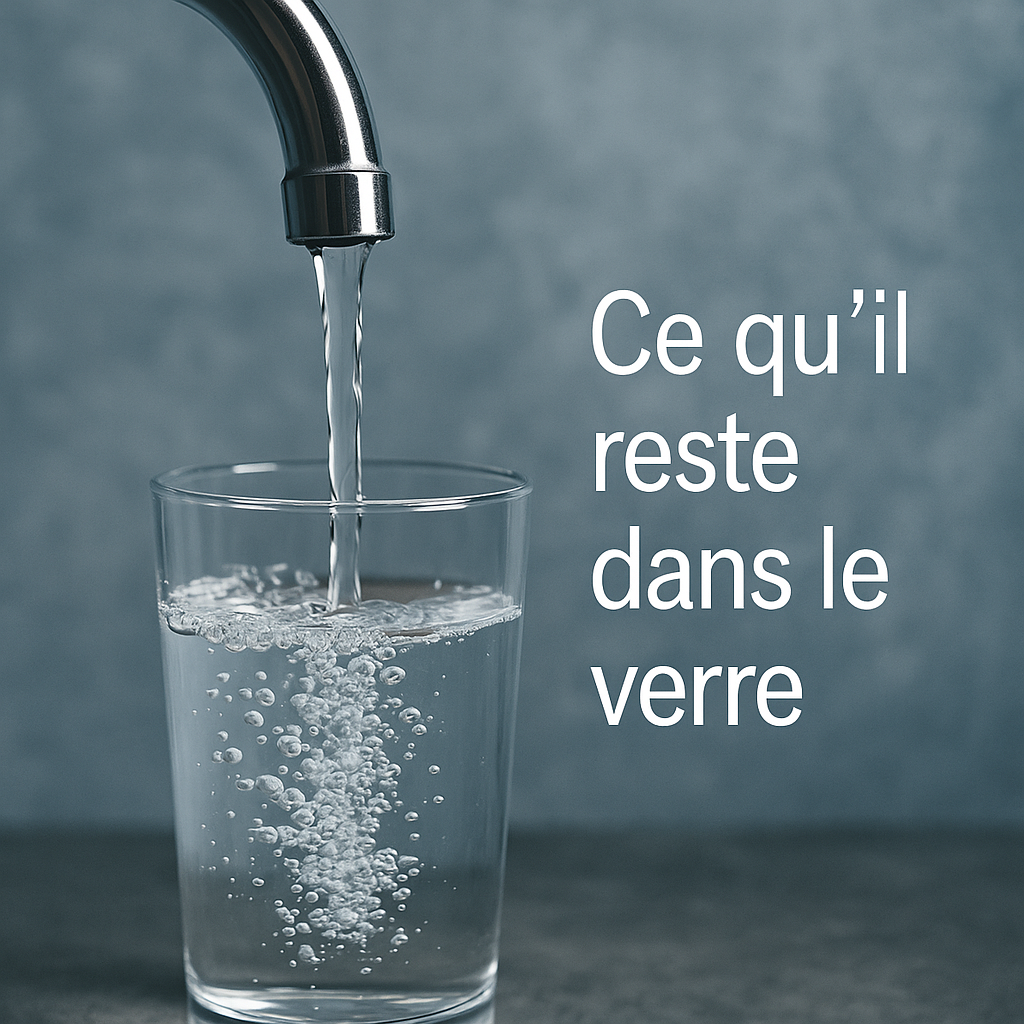
7 août 2025
Tout le monde boit de l’eau. Mais personne ne sait ce qu’il y a vraiment dedans. Et quand on le découvre, il est souvent trop tard.
En France, l’eau du robinet est l’un des biens publics les plus partagés. On y a accès 24 heures sur 24, dans chaque foyer, chaque hôpital, chaque école. Elle semble propre, transparente, inépuisable. Mais cette confiance repose sur un mythe. Car l’eau potable n’est plus ce qu’elle était. Et les menaces qui pèsent sur elle ne sont ni rares, ni invisibles. Elles sont déjà là. Dans les nappes, dans les canalisations, dans nos verres.
Le Haut-Commissariat au Plan et France Stratégie viennent de publier un rapport glaçant : à l’horizon 2050, 88% du territoire métropolitain pourrait être en situation de tension hydrique sévère l’été. Non seulement l’eau va manquer, mais celle qui restera pourrait ne plus être conforme à nos critères sanitaires. La crise de l’eau n’est plus un risque : c’est une trajectoire. Et elle commence bien avant 2050.
https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/leau-en-2050-graves-tensions-sur-les-ecosystemes-et-les-usages
Les contaminants ne sont plus l’exception. Pesticides, nitrates, PFAS, résidus médicamenteux, microplastiques, chlorure de vinyle monomère... Tous ces polluants sont désormais mesurés dans l’eau potable française. Selon Le Monde, en se fondant sur les bilans des agences régionales de santé, plus de dix millions de personnes ont consommé en 2022 une eau non conforme, principalement en raison de la présence de pesticides ou de leurs résidus. La plupart n’en ont rien su.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/05/29/le-temps-est-a-l-action-pour-securiser-le-principe-de-l-eau-potable-au-robinet-pour-tous_6236128_3232.html
Car les dépassements ponctuels sont encore tolérés. Les métabolites de pesticides, souvent plus mobiles et persistants que leurs molécules mères, sont surveillés avec retard. Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour éliminer les micropolluants. Et les réseaux de distribution vieillissants aggravent la situation : les anciennes canalisations en PVC peuvent relarguer du chlorure de vinyle, un cancérogène avéré, sans que les habitants n’en soient informés.
L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout le monde en boit. Ces dernières années, plusieurs études ont révélé la présence constante de médicaments dans les réseaux d’eau potable : antibiotiques, antidépresseurs, antidiabétiques, anticancéreux, hormones, antalgiques... Tous types de molécules se retrouvent dans les cours d’eau, les nappes, et parfois jusque dans les verres. Le plus inquiétant ? Tous les principes actifs ne sont même pas recherchés. Leur impact sanitaire, lui, reste encore largement sous-estimé.
https://syndicat-infirmier.com/Des-medicaments-dans-l-eau-et-personne-pour-les-filtrer.html
Même les eaux réputées de bonne qualité ne sont pas épargnées. Le suivi des substances émergentes reste lacunaire. Les normes évoluent trop lentement. Et les dispositifs de surveillance varient fortement selon les territoires. Certaines eaux embouteillées ne sont pas exemptes de controverses. Des enquêtes parlementaires ont récemment mis en lumière des pratiques de traitement non déclarées, contraires aux critères réglementaires de l’eau « naturelle ». Des questions subsistent sur la transparence des contrôles, la traçabilité des sources, ou encore la qualité réelle des eaux après stockage prolongé.
Les PFAS sont surnommés « polluants éternels » pour une bonne raison : ils ne se dégradent pas dans l’environnement. Leur usage industriel massif les a rendus omniprésents. Résistants à l’eau, à la chaleur, à la graisse, on les retrouve dans les mousses extinctrices, les textiles, les emballages. Et désormais… dans l’eau du robinet.
En 2023, une enquête collaborative a montré que près d’un prélèvement sur deux en France contenait des PFAS, parfois à des niveaux très supérieurs aux recommandations européennes. À Paris, les concentrations en acide trifluoroacétique (TFA), un sous-produit issu de certains pesticides, atteignent plus de 6000 ng/L, alors que la limite de sécurité est fixée à 100 ng/L.
https://www.franceinfo.fr/environnement/pollution/pfas/la-regie-eau-de-paris-porte-plainte-contre-x-pour-pollution-aux-pfas_7157085.html
À Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, la population a appris que l’eau du robinet était contaminée. Des recommandations ont été émises pour que les femmes enceintes, nourrissons et personnes vulnérables ne la consomment plus. Des solutions techniques sont promises pour 2026. En attendant, les habitants improvisent. Ceux qui peuvent se tournent vers l’eau en bouteille. Les autres n’ont pas le choix.
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/Communiques-de-presse-2025/Restriction-de-l-usage-de-l-eau-potable-dans-l-agglo-de-Saint-Louis-pour-les-personnes-sensibles
La contamination chimique n’est qu’un des deux visages du problème. L’autre, c’est la quantité. Le rapport du HCSP dresse une cartographie inquiétante des prélèvements et des consommations à l’horizon 2050. Si rien ne change, 88 % du territoire hexagonal pourrait connaître des tensions hydriques modérées ou sévères l’été. Et pas seulement dans le sud. Le quart nord-est est également concerné.
Cette situation n’est pas uniquement liée à la météo. Elle résulte d’un déséquilibre structurel entre les ressources disponibles et la demande. Or cette demande explose. L’agriculture prélève une part considérable de l’eau douce, et en consomme l’essentiel : elle ne la restitue pas au milieu après usage. L’eau utilisée pour l’irrigation est évapotranspirée, c’est-à-dire absorbée par les plantes ou perdue dans l’atmosphère. Contrairement à l’eau domestique, elle ne revient ni dans la nappe, ni dans la rivière.
En juillet, dans le bassin de l’Adour-Garonne, 75 % de l’eau disponible a été absorbée par l’irrigation agricole. Ce qui signifie qu’il ne reste presque rien pour les rivières, les nappes, les habitations en aval.
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/occitanie/irecontenu/telechargement/129830/955630/file/20250724_cp%20bassin.pdf
Les tensions sur l’eau ne sont pas que climatiques. Elles sont aussi sociales, économiques et politiques. En témoignent les polémiques récentes autour des mégabassines, des forages, des projets industriels, des captages pour l’eau en bouteille ou des usages agricoles intensifs.
En 2022 déjà, 86 % du territoire était soumis à des arrêtés sécheresse. Les interdictions d’arrosage, les fermetures de fontaines, les restrictions d’usage ne sont qu’un avant-goût. À mesure que la ressource se raréfie, chaque goutte devient un enjeu de pouvoir. Et les arbitrages ne sont pas toujours faits dans l’intérêt général.
Le rapport évoque un avenir où les prélèvements, les consommations et les tensions ne cesseront de croître. Y compris en hiver. Dans certains bassins, comme celui de la Moselle ou du Rhône, les tensions pourraient durer plus de six mois par an. Même un printemps-été humide ne suffirait plus à restaurer l’équilibre.
La dégradation de la qualité de l’eau a des conséquences concrètes sur la santé des populations. Or ces effets ne sont pas toujours visibles. Ils s’accumulent lentement : troubles digestifs, dermatites, effets sur la grossesse, cancers, perturbations endocriniennes... Les plus vulnérables sont les premiers exposés : enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes immunodéprimées.
Dans ce contexte, le rôle de l’infirmière généraliste de terrain prend une importance particulière. Parce qu’elle connaît les patients, les familles, les habitudes. Parce qu’elle est souvent la première à constater une recrudescence de symptômes inexpliqués dans un quartier, une école, un EHPAD. Parce qu’elle est en lien avec les mairies, les services de l’eau, les agences régionales de santé.
L’infirmière peut jouer un rôle de veille sanitaire, de repérage des signaux faibles. Elle peut aussi sensibiliser les familles à des gestes simples de prévention, surtout pour les personnes fragiles : utiliser un filtre à charbon actif, ne pas préparer les biberons avec l’eau du robinet en cas de doute, lire les bulletins de qualité publiés par les ARS.
Elle peut surtout poser des questions. Insister pour obtenir des réponses. Relier les acteurs locaux. Dans un monde où les indicateurs techniques ne suffisent plus, la vigilance humaine reste irremplaçable.
La sobriété n’est plus une option. C’est un choix de société, qui passe par la généralisation de l’agroécologie, la régulation stricte des surfaces irriguées, la sobriété dans les usages domestiques et industriels.
En attendant, la question reste entière : combien de verres faudra-t-il boire avant que l’eau ne devienne un problème de santé publique reconnu, surveillé, et mieux partagé ?
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************