Médicaments cytotoxiques : sauver des vies en risquant la sienne
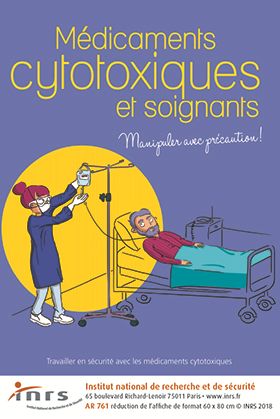
24 août 2025
Ils sauvent des vies. Mais ils menacent aussi celles qui les administrent. Dans les services d’oncologie, en rhumatologie, en dermatologie ou à domicile, les cytotoxiques sont devenus des compagnons de route du soin moderne. Leur mission est claire : bloquer l’ADN des cellules tumorales. Leur défaut est connu : ils ne sont pas sélectifs. Au-delà du patient, ils touchent ceux qui préparent, transportent, posent, débranchent, nettoient, ramassent. Des soignants. Des humains.
Le risque n’a rien d’hypothétique. Il est documenté, mesuré, chiffré. Les publications s’accordent : l’exposition professionnelle persiste, parfois à bas bruit, souvent par petites touches, toujours de trop. Les effets aigus (irritations, allergies) existent. Les effets différés inquiètent davantage : troubles de la fertilité, fausses couches, malformations, cancers. Ce n’est pas une rumeur, c’est un constat étayé par des cohortes, des recensements et des dosages biologiques.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8952240/
La contamination ne commence pas au lit du patient et ne s’arrête pas au retrait de la perfusion. Elle peut survenir à chaque maillon du circuit : emballages souillés, glacières de transport mal nettoyées, projections à la pose/dépose, gouttelettes, surfaces, textiles, déchets, mais aussi excrétas (urines, vomissements, selles, sueur) dans lesquels on retrouve le produit inchangé ou ses métabolites actifs. La chambre, le chariot, la poignée de porte, le téléphone, la souris d’ordinateur : autant de vecteurs potentiels. Les mesures nationales l’ont montré noir sur blanc.
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/soignants-et-medicaments-cytotoxiques.-place-de-la-biometrologie-dans-la-maitrise-des-risques-dans-le-temps
Dans un centre hospitalier exclusivement dédié à la cancérologie, une équipe INRS a suivi les soignants : 78 % des 23 participants avaient au moins un échantillon urinaire positif au marqueur du 5-fluorouracile, et 72 % des prélèvements de surface (paillasses, poignées, téléphones, souris de PC, sols, plateaux de soins, potences, etc.) étaient contaminés. Autrement dit : l’environnement de soin est un réservoir persistant.
Les données multicentriques confirment l’ampleur du phénomène. Dans une série conduite par l’INRS dans 12 hôpitaux, 55 % des 104 infirmiers et 58 % des 48 aides-soignants avaient au moins un échantillon urinaire positif. Détail qui change tout sur le terrain : les gants vinyle, courts au poignet, se sont révélés insuffisants pour protéger l’avant-bras lors de la manipulation des excrétas et de la literie.
Au-delà de ces chiffres, les revues systématiques internationales dressent le même tableau : une fraction importante des soignants présente des traces d’antinéoplasiques ou de leurs métabolites dans les fluides biologiques, et les infirmières constituent la profession la plus exposée lorsqu’elles manipulent ces médicaments au quotidien.
Les signaux sont clairs pour la reproduction : méta-analyses et cohortes montrent un excès de fausses couches, de mortinaissances et de malformations chez les infirmières exposées, surtout quand les dispositifs de protection et les mesures d’ingénierie ne sont pas systématiques. Pour les cancers, des études observent des excès pour certains sites (sein, rectum) chez des populations manipulant des anticancéreux, avec hétérogénéité selon les méthodes et les expositions concomitantes (travail de nuit, autres agents).
Pourquoi l’exposition persiste ? Parce que le risque est invisible : pas d’odeur, pas de brûlure immédiate, des effets parfois différés de plusieurs années. Parce que la banalisation guette : répéter les mêmes gestes quotidiennement entretient l’illusion du contrôle. Mais surtout parce que les moyens ne suivent pas toujours : équipements hétérogènes, ruptures de stock d’EPI adaptés, filières déchets incomplètes, nettoyages insuffisamment standardisés.
https://www.inrs.fr/publications/essentiels/medicaments-cytotoxiques.html
Et aussi parce que la formation s’arrête trop souvent à l’embauche, quand l’enjeu exige des rappels réguliers et des RETEX d’incident (déversement, fuite, projection). Utiliser les retours d’expérience (RETEX) est essentiel pour gérer au mieux les risques sanitaires. Les organismes européens de santé au travail tirent la sonnette d’alarme depuis des années : « encore trop d’exposition ».
https://www.cdc.gov/niosh/healthcare/risk-factors/antineoplastic-agents.html
Pour le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI, voici ce qu’il faut changer dès maintenant :
1) Prendre l’exposition au sérieux comme un risque chimique majeur.
– Intégrer réellement les antinéoplasiques dans les plans de prévention. La liste CMR (liste nominative des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques) n’est pas un papier de plus : c’est la colonne vertébrale de la traçabilité des expositions aux cytotoxiques : elle protège les équipes (suivi médical, reconnaissance ultérieure), sécurise les pratiques (preuves d’organisation) et rendra opposable la démarche de prévention. En milieu de soins, elle doit couvrir tout le circuit (réception → transport → administration → excrétas → linge → surfaces → déchets), y compris la co-activité (bionettoyage, blanchisserie, intérim).
– Reconnaître et tracer l’exposition : enregistrement des incidents.
2) Avoir des EPI de bon niveau : gants nitrile/néoprène, surblouses manches longues anti-projection + tablier imperméable si risque d’éclaboussure, lunettes/visière + masque lors des gestes à risque. Oubliez gants vinyle courts pour les excrétas et la literie : il n’assure pas la protection attendue !
Ce manque de moyens adaptés n’est pas aussi visible que les sacs poubelles portés en guise de protection lors du pic Covid, mais les conséquences sur la santé des soignants sont dramatiques : 4 % des cancers en France sont dus à une exposition professionnelle. Les infirmières, qui manipulent principalement ces médicaments, ont un risque 2,73 fois plus élevé de développer un cancer du sein par rapport à la population générale.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10751212/#:~:text=Our%20study%20did%20not%20measure,compared%20to%20the%20general%20population.
3) Organiser le soin autour de la sécurité.
– Donc exclure les femmes enceintes/allaitantes des tâches à risque, et prévoir les remplacements pour éviter les contorsions de planning qui font sauter les garde-fous.
– Réaliser annuellement une évaluation du risque de cancérogénicité pour les différents personnels impliqués afin de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection adéquats
– Mettre en place un suivi des expositions des professionnels notamment par la réalisation d’une surveillance biologique des expositions tous les 3 ans par la médecine du travail
4) Former et ré-entraîner.
– En formation initiale, intégrer un module de formation sur le risque cancérogène lié à ces médicaments
– Sensibiliser au risque cancérogène le personnel en contact avec ces substances, dès leur prise de poste et lors de l’entretien annuel, à la gestion des déchets et des excreta (manipulation, nettoyage)
– Travailler en association avec les libéraux en lien avec le service pour les chimiothérapies à domicile (gestion des excrétas, circuits déchets, information aux proches), afin de définir des procédures standardisées à appliquer dans les différentes situations d’exposition.
La prévention n’est pas une surcharge bureaucratique. C’est ce qui sépare une pratique moderne d’une routine à risques. La réalité est simple : protéger les soignants, c’est protéger les patients. Un service où l’on sait qui fait quoi, comment on nettoie, quel gant on porte et quand on le change est un service plus sûr pour tous.
Les chiffres ne disent pas tout, mais ils obligent. Quand 78 % d’une équipe exposée présente des traces urinaires d’un cytotoxique, quand 72 % des surfaces d’un service sont contaminées, quand plus d’un soignant sur deux a déjà eu un échantillon positif en multicentrique, nous ne sommes plus dans la sensibilisation : nous sommes dans la mise en conformité. Maintenant. Prendre soin des soignants, c’est déjà leur permettre de soigner en sécurité.
*********************
Question aux soignants : Vos EPI sont-ils adaptés aux excrétas et à la literie ? Vos procédures de sécurité en cas d’incident sont-elles connues des nouveaux et des vacataires ? La réponse à ces questions, ce n’est pas une case à cocher. C’est la condition pour que soigner ne rime jamais avec s’empoisonner.
**********************
Et vous, qu’en pensez-vous ? Partagez votre point de vue. Echangez avec nous sur
twitter https://x.com/infirmierSNPI/status/1830605997188231643
facebook https://www.facebook.com/syndicat.infirmier/
linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7236362308703191041/
**********************
Nos articles vous plaisent ?
Seul, vous ne pouvez rien.
Ensemble, nous pouvons nous faire entendre ! Rejoignez nous !
https://www.syndicat-infirmier.com/Comment-adherer.html
**********************
– Lutte contre les risques liés aux cytotoxiques : peut mieux faire, juge le SNPI
https://www.infirmiers.com/profession-ide/competence-et-role-propre/lutte-contre-les-risques-lies-aux-cytotoxiques-peut-mieux-faire-juge-le-snpi
– Le Syndicat national des professionnels infirmiers insiste sur la mise en place de quatre changements dans le quotidien afin de mettre en place une véritable lutte contre l’exposition aux risques des médicaments cytotoxiques.
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20250826-gestion-des-risques-la-lutte-contre-l-exposition